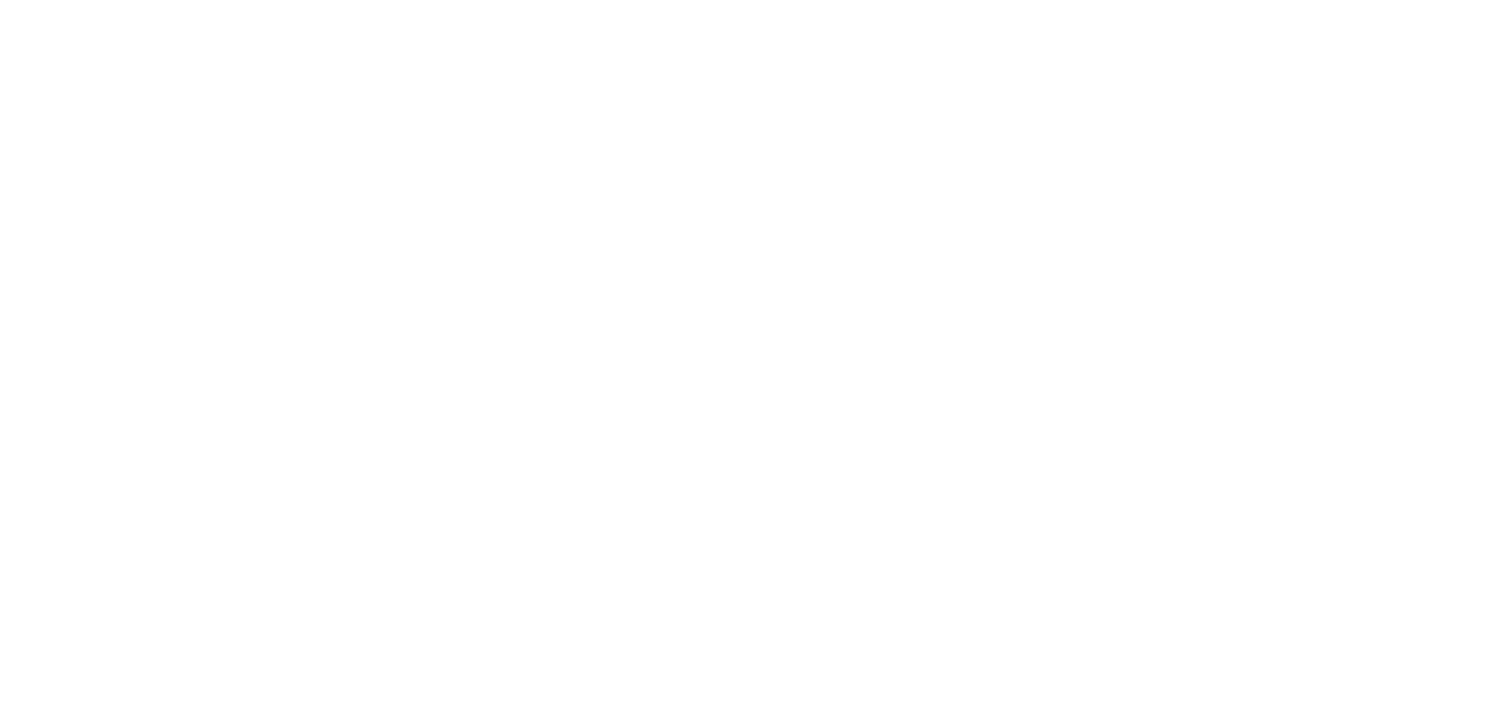Bain de jouvence à Biarritz !
Retour du festival Nouvelles Vagues 2025 par David Ezan
L’affiche du festival Nouvelles Vagues 2025.
C’est dans la houle tempétueuse que s’est inauguré la – seulement – troisième édition d’un tout jeune festival consacré à la jeunesse, face aux vagues folles d’un Biarritz de chic et de choc. La venue de l’iconique Sofia Coppola, ici pour présenter son coup d’essai, coup de maître VIRGIN SUICIDES (1999), aurait presque éclipsé le véritable événement de sa première soirée : la présentation du malicieux NOUVELLE VAGUE (en salles le 8 octobre) de Richard Linklater, dont le titre était définitivement tout trouvé pour le festival. C’est dire que s’y raconte la jeunesse, celle d’hier et d’aujourd’hui : celle des trublions qui réalisèrent À BOUT DE SOUFFLE (1960) et de ceux qui les incarnent, les doublent, les singent aussi bien. Reparti bredouille du Festival de Cannes, voilà pourtant un hommage digne de ce nom au cinéma tout entier, par et pour une jeunesse dont le désir croule parfois sous le poids de l’histoire. À rebours de toute sacralisation, NOUVELLE VAGUE ne le revitalise pas seulement : il en déplace les curseurs, centrés cette fois sur la fabrication pure ; en fait sur l’essentiel.
Les cinéastes annoncés en compétition, la grande majorité pour des premiers films, en ont d’ailleurs tiré toutes les leçons. C’était le cas pour l’étonnant THE CROWD, signé par l’Iranien Sahand Kabiri, pour l’instant sans distributeur français, tourné en 12 jours, qui voit une bande de fêtards organiser une soirée clandestine. Dans la lignée d’un réalisme théâtral à la Jafar Panahi, on pense en effet à la Palme d’or, à son petit groupe de personnages unis par une même frustration rageuse, mais chez Kabiri c’est la jeunesse – la sienne – qui fait le cœur même du récit. Les visages, les allures qui peuplent le film ne sont pas différents des nôtres et c’est sans doute le plus fort, car surgit soudain une jeunesse affranchie de toutes les représentations – qu’elles soient culturelles, sociales, sexuelles – en vigueur dans le cinéma iranien, jusqu’à Farhadi ; représentations auxquelles nous, Occidentaux, étions habitués. C’est le propre d’un festival consacré aux récits de jeunesse : actualiser les représentations, « mettre à jour » ce que peut le cinéma en la matière. Y compris sur des formules qu’on croirait éculées, comme celle du marginal dans URCHIN (en salles le 11 février 2026), récompensé du Grand Prix. Malgré sa facture un peu timide, le premier film réalisé par l’acteur Harris Dickinson (Sans filtre, Babygirl) dresse un pont entre la figure encore très stigmatisée du SDF – son héros, Mike, dort en pleine rue – et celle plus désirable, plus politisée du « marginal » qui rejette volontairement le système consumériste. Deux dimensions qui cohabitent en un même personnage, tiraillé par ses contradictions internes, génialement interprété par Frank Dillane. Mais la plus belle surprise du festival, et de loin, se nommait L’ENGLOUTIE (en salles le 24 décembre), justement auréolée d’un Prix du jury. À travers l’histoire d’une jeune institutrice venue « civiliser » un hameau rural à la fin du XIXe siècle, dans la République naissante, la cinéaste Louise Hémon questionne en fait la notion même de représentation ; il s’agit pour son héroïne Aimée – sublime Galatéa Bellugi – de lisser culturellement une région, un pays, sous couvert de progrès. Le film répond à cette froide technicité, celle de la science, par un langage et une puissance de feu qui renouent avec les sensations les plus ancestrales. Et dont la force va bouleverser l’institutrice elle-même, faire vaciller ses certitudes – y a-t-il plus beau mouvement pour un récit ? Sur un mode franchement immersif, le film ressuscite un folklore comme une part tragiquement oubliée de notre histoire à toutes et tous. Il ouvre une brèche sur la diversité des croyances et des désirs.
Un programme relayé enfin par la section « Les étudiants vous parlent », qui voit 5 étudiants de 5 écoles de cinéma internationales à présenter un film qui représente à leurs yeux la jeunesse de leur pays. L’occasion d’y découvrir des œuvres parfois jamais diffusées en France, comme le film taïwanais GIRLFRIEND, BOYFRIEND (2012), mélo brûlant qui questionne l’émancipation – réelle ou supposée – de la jeunesse après la démocratisation du pays dans les années 1990. Une découverte parmi d’autres issues d’Espagne, du Brésil, du Maroc, dans un véritable bain de jouvence où s’entrecroisent des dizaines d’étudiantes et d’étudiants animés par une passion commune.
Plus d’informations sur le festival : https://www.nouvelles-vagues.org/